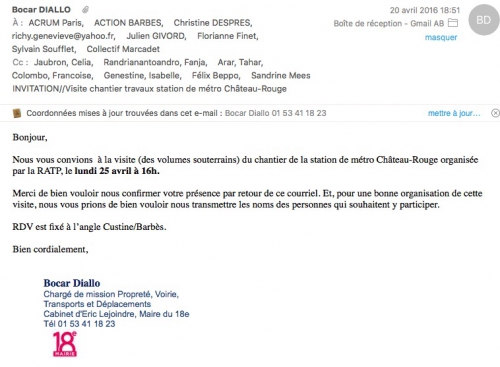La RATP a organisé une visite du chantier de rénovation de la station de métro Château Rouge lundi 25 avril. Malgré le choix de la date en plein milieu des vacances scolaires parisiennes et les troupes chez nous un peu clairsemées, nous avions trouvé deux adhérents particulièrement motivés par la visite et disponibles à 16 heures un lundi. Pas une mince affaire.
Sur demande de la RATP et par l'intermédiaire du chargé de mission de la mairie, nous avions même communiqué la pointure de nos adhérents à la RATP pour qu'on leur fournisse sur place des chaussures appropriées en plus des casques réglementaires. Tout était en place pour une visite intéressante par deux personnes connaissant parfaitement le quartier et la station de métro pour y avoir transité pendant plus d'une dizaine d'années. Du côté du blog, nous étions très satisfait de pouvoir assurer le suivi de ce chantier dont nous avons relaté l'évolution à chaque fois que l'occasion s'en présentait. N'hésitez pas à relire notre article d'il y a tout juste un an, il est ici.
C'était une bonne idée de faire une visite de chantier pour permettre à la presse locale (c'est un grand mot mais nous sommes lus par environ un millier de personnes par jour...), nous, mais aussi le 18e du Mois, qui édite un mensuel traitant du 18e exclusivement, pour permettre donc à ces vecteurs d'information de proximité de donner des nouvelles précises et documentées de la station Château rouge, dont le chantier tient beaucoup de place dans le quartier, et parfois se pose au centre de polémiques (comme le changement de sens de circulation de la rue Dejean, ou le retrait des contre-étalages).
Nous étions donc dûment inscrits en réponse à l'invitation faite quelques jours plus tôt :
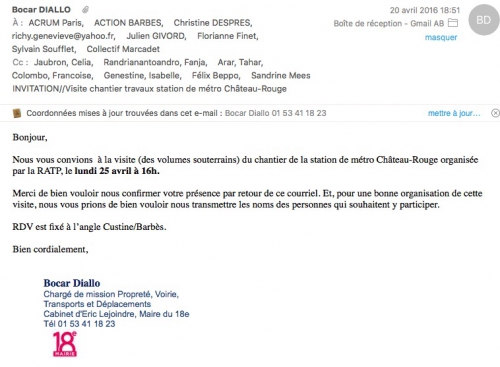
Lundi 27 avril, 16h. Petit attroupement et grand enthousiasme. Se trouvent réunis le maire du 18e, Eric Lejoindre, son adjoint à la voirie et aux transports Félix Beppo, son chargé de mission, Bocar Diallo, une chargée de communication de la RATP, un étudiant en architecture, une représentante d'Acrum (l'association Château Rouge des usagers du métro) et quelques autres dont une journaliste du 18e du Mois, une petite dizaine en tout. Nos deux émissaires en élèves studieux, stylo, carnet et appareil photo en bandoulière, incorporent le petit groupe qui remonte la rue Custine où les accueillent d'autres responsables déjà sur place.
Mais, là, patatras, en fait dix personnes seulement pouvaient entrer pour des raisons de sécurité — apparemment un problème sur un plancher de chantier un peu fragile sous le boulevard Barbès. Une fois les élus passés, Acrum ensuite, l'étudiant en archi, et la représentante du 18e qui a du élever la voix, le compte y était. Quelqu'un s'est inquiété pour nous, la RATP a tranché : — Alors AB, oui, mais une seule personne. — Ah, non, nous nous sommes inscrits à deux, régulièrement, pas question de laisser l'un de nous sur le côté. Il faut dire que même le chargé de mission de Félix Beppo est aussi resté sur le flanc. On ne plaisante pas avec la sécurité à la RATP ! D'un côté, c'est réconfortant, mais de l'autre... quelle organisation calamiteuse. Deux autres personnes, dûment inscrites comme nous, en ont été pour leurs frais.

Le plus idiot est que nous avons appris par Bocar Diallo lui-même que la RATP a doublé la visite à 17h, sans doute de façon improvisée, et que nos adhérents n'en ont même pas été avertis avant de quitter les lieux. Ils auraient bien évidemment patienté, leurs pas les conduisant jusqu'à chez Joseph Gibert par exemple...
Il vous reste à feuilleter l'excellent mensuel du 18e — disponible dans tous les bons kiosques ou librairies de l'arrondissement au prix de 2,50 € — dans son édition de mai pour retrouver ce que nous aurions pu vous dire ici.