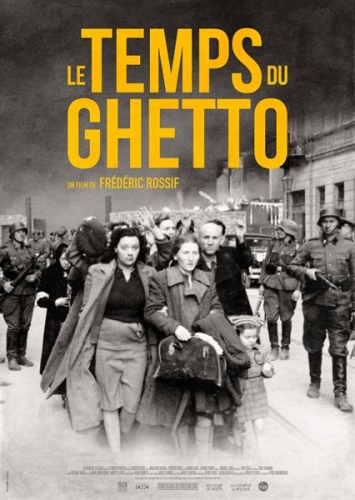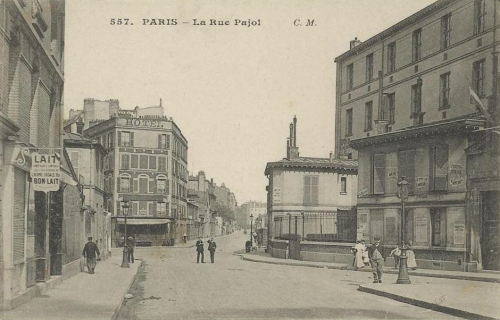Entre 1875 et 1914 environ, la vie artistique et intellectuelle à Paris se déroulait essentiellement à Montmartre. Dans un périmètre assez réduit allant de la place de Clichy à Barbès et des Grands Boulevards au haut de la Butte, se côtoyaient nombre de grands artistes et intellectuels : Renoir et les Impressionnistes, Van Gogh, Toulouse Lautrec, Picasso mais aussi Verlaine, Rimbaud, Zola, Satie, Debussy, ... pour ne citer qu'eux, et bien d'autres.
Des lieux ont marqué leur présence. Certains ont définitivement disparu comme le Bateau Lavoir sur la Butte, le bal Tabarin et le Chat Noir rue Victor Massé dans le 9e, les cafés l'Abbaye de Thélèm et La Nouvelle Athènes place Pigalle, le Paradis et l'Enfer boulevard de Clichy. D'autres ont survécu tant bien que mal jusqu'à aujourd'hui comme La Cigale boulevard de Rochechouart, le Divan rue des Martyrs, l'emblématique Moulin Rouge place Blanche, l'Auberge de la Grande Pinte, devenu en 1889 le célèbre Ane Rouge (aujourd'hui le restaurant Paprika), mitoyen de l'Auberge du Clou, etc.
Un de ces lieux, certes moins prestigieux que ceux mentionnés, vient de disparaitre à jamais. Il s'agit de l'Auberge du Clou située 30 avenue Trudaine. C'est, à certains égards, aussi un lieu emblématique. S'y rencontrèrent dès 1883, les opposants au “Chat noir” comme Alfred Jarry mais aussi Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine, les peintres et caricaturistes Henri Riviere, Willette, Caran d'Ache, Suzanne Valadon, les musiciens Erik Satie et Claude Debussy y seront pianistes, le dramaturge Georges Courteline, et Alphonse Allais dont c'était leur café préféré , puis Mistinguett et Maurice Chevalier... et bien d'autres venant en voisins du quartier. L'Auberge du Clou devient rapidement un sanctuaire littéraire et artistique renommé. Le "Clou" permettait aux artistes fauchés d'y accrocher leur œuvre en attendant de pouvoir régler leur addition.
L'Auberge du Clou et sa voisine l'auberge de La Grande Pinte
qui deviendra l'Ane Rouge avenue Trudaine
à la fin du XIXe siècle Source : gallica .fr
l'Auberge du Clou vers 1905, Source : cparama.com
l'Auberge du Clou en 2010. Si l'intérieur avait été assez profondément remanié, du moins la façade restait-elle inchangée

L'ancienne Auberge du Clou octobre 2020 en travaux
Nous assistons impuissants à un réel effacement de la mémoire du lieu avec aujourd'hui cette nouvelle devanture moderne, banale et sans âme pour abriter une activité de restauration rapide parait-il. Tout cela se fait en parfaite connaissance de cause puisque des contacts avec la gérante pour l'informer de la qualité de l'endroit ont eu lieu au préalable. C'est donc une destruction délibérée.
Il ne fait pas de doute que la responsabilité de ce saccage incombe directement au propriétaire, à la copropriété qui a nécessairement donné son accord pour modifier la façade du 30 avenue Trudaine comme la Loi lui impose, la Direction de l'Urbanisme de la Ville de Paris qui ne se soucie guère de la mémoire de ces lieux historiques de notre ville en ne mentionnant même pas ceux-ci sur le Plan Local d'Urbanisme et enfin, et surtout, l'Architecte des Bâtiments de France chargé du 9e arrondissement qui n'a pas jugé, au mieux, l'endroit suffisamment important pour le laisser détruire, soit au pire, ignorant totalement la qualité de celui-ci.
On peut trouver des informations à propos de l'Auberge du clou dans :
• La vie secrète de Montmartre de Philippe Mellet (Ed. Omnibus) ;
• Vie & Histoire du IXe arrondissement de Jocelyne Deputte (ed. Hervas) ;
• Guide Trudaine Rochechouart dans tous ses éclats (ed. Mairie de Paris) ;
et sur Internet :
• Montmartre secret : avenue Trudaine côté pair ;
• CPArama cartes postales anciennes 9e arrondissement ;
• 9e Histoire : Autour de la place Pigalle au temps de la Bohême montmartroise ;
• Blog Autour du Père Tanguy : l'Auberge du Clou, Zola, Mousseau, 30 avenue Trudaine ;
• et bien sûr le site de la BNF Gallica.
![Quartiers_des_artistes_peintres_sculpteurs_[...]Chauvet_Jules-Adolphe_btv1b8456097m_1.jpeg](http://actionbarbes.blogspirit.com/media/00/02/2354155285.jpeg)


![F_Appel_Parrot_&_Cie_[...]_btv1b53015894s_1.jpeg](http://actionbarbes.blogspirit.com/media/00/02/1741363409.jpeg)