Flora Tristan et les femmes de son temps
7 avril 1803-14 novembre 1844
par Bernard Vassor
"L'homme le plus opprimé peut opprimer un être qui est sa femme. Elle est la prolétaire du prolétaire même".
Flora Tristan « L’Union Ouvrière »
Comment résumer en quelques lignes la vie "ardente et trépidante" d'une femme qui a lutté jusqu'à l'épuisement pour établir une justice sociale dans la première moitié du XIX° siècle ? Le titre de son premier ouvrage en 1836 : "Nécessité de faire un bon accueil aux femmes étrangères" suffit à démontrer la modernité du combat de celle qui fut aussi une grande voyageuse.
Ses pétitions, adressées aux députés pour obtenir l'abolition de la peine de mort, attendront un siècle et demi pour aboutir en France. La mesure, en revanche, n'est toujours pas appliquée dans le nouveau monde.

Le code Napoléon avait réduit la femme à l'état d'infériorité et d'assujettissement. Flora s'engagea avec "ses soeurs" saint-simoniennes dans le combat pour le rétablissement du divorce et le droit des femmes à disposer d'elles-mêmes. Véritable créatrice du syndicalisme, elle fonda "L'Union Ouvrière » avec un but très clair : organiser les travailleurs, exiger le droit au travail, veiller à l'éducation des enfants et verser une pension aux ouvriers âgés. Avec elle il faut citer et remettre en mémoire celles qui furent les pionnières du mouvement féministe et qui luttèrent parfois jusqu'à la mort pour voir la réalisation de leur combat. A "La Tribune des femmes" premier journal féminin militant, au 27 rue Laffitte en 1832, on pouvait rencontrer aux réunions du jeudi, Claire Demar et Marie-Reine Guindorf qui ont connu une fin tragique, Suzanne Voilquin "Fille du Peuple", Jeanne Deroin, Claire Bazard, Désirée Véret (Desirée Gay) et Eugénie Niboyet qui organisa à Lyon en 1832 la première organisation féminine "Pour la Paix dans le monde" (l’ancêtre de Simone Landry).
Les principaux journaux dirigés en majorité par des ouvrières s'intitulaient : La Femme Libre, La Femme Nouvelle, L'Apostolat des Femmes, La Tribune des Femmes, La Voix des Femmes.
Flora Tristan est morte d'épuisement à Bordeaux, seule ville en France qui l'honore chaque année le 14 novembre jour de sa mort. La maison du Pérou et L'institut d'Histoire sociale d'Aquitaine organisent une manifestation commune au cimetière de la Chartreuse.
Aux sources de cet article :
Dominique Desanti première biographe de Flora et Evelyne Bloch-Dano la dernière en date avec "La femme messie", Stéphane Michaud organisateur depuis plus de 20 ans de colloques réunions et tables rondes consacrés à notre héroïne. Pour le bicentenaire de sa naissance, j'avais organisé une série de manifestations en liaison avec le service culturel de l'Ambassade du Pérou dirigé par une femme admirable: Madame Carolina Belaundé et par l'ambassadeur du Pérou Monsieur Javier Perez de Cuellar ancien secrétaire général des Nations unies.
Nadia Prete déléguée culturelle à la Mairie du IX° a conduit et soutenu très efficacement ces réunions.
Dans le monde entier, des associations Flora Tristan ont été crées pour venir en aide aux femmes battues. Célébrée par André Breton qui possédait une partie de sa correspondance mise en vente lors de la dispersion du « Musée Breton » au 42 rue Fontaine.

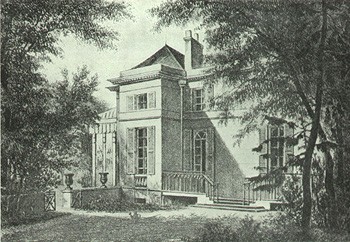




 Vers 1772, la tragédienne Françoise Marie-Antoinette Joseph Saucerotte, dite Mlle Raucourt (1756-1815), habita la maison qui faisait l’angle de ces rues. Des historiens assurent que Louis XV, connaissant sa réputation sulfureuse lorsqu’il il la vit aux Tuileries dans le rôle de Didon, eut envie de cette femme. C’est la du Barry, maîtresse du Roi en titre, qui lui servit d’intermédiaire pour lui procurer un tête à tête. Ce qui explique peut-être l’impunité dont elle put jouir après ses multiples provocations. Elle s'affichait ouvertement avec ses maîtresses dont Madame Souk (Jeanne Françoise Marie Sourques). Selon Grimm, elle aurait créé là une sorte de loge maçonnique féminine dont elle assura la présidence: « La loge Androgyne » ou « la secte des Anandrynes ». Après la mort de Louis XV en 1774, la belle « Sapho » perdit son immunité et fut renvoyée de la Comédie Française et emprisonnée au Temple, qui était alors la prison pour dette. Elle s’enfuit en Russie et rentra trois ans plus tard grâce à la protection de Marie-Antoinette. Ses funérailles en 1815 à l’église Saint Roch furent l’objet d’un nouveau scandale. Elle habitait cette paroisse, et bien qu’elle ait fait à l’église des dons considérables, l’entrée de ses restes mortels fut refusée par le curé. Le peuple indigné enfonça les portes. Alerté, Louis XVIII, envoya un de ses aumôniers pour célébrer l’office funèbre. Elle a été inhumée au cimetière de l’Est (Montparnasse)
Vers 1772, la tragédienne Françoise Marie-Antoinette Joseph Saucerotte, dite Mlle Raucourt (1756-1815), habita la maison qui faisait l’angle de ces rues. Des historiens assurent que Louis XV, connaissant sa réputation sulfureuse lorsqu’il il la vit aux Tuileries dans le rôle de Didon, eut envie de cette femme. C’est la du Barry, maîtresse du Roi en titre, qui lui servit d’intermédiaire pour lui procurer un tête à tête. Ce qui explique peut-être l’impunité dont elle put jouir après ses multiples provocations. Elle s'affichait ouvertement avec ses maîtresses dont Madame Souk (Jeanne Françoise Marie Sourques). Selon Grimm, elle aurait créé là une sorte de loge maçonnique féminine dont elle assura la présidence: « La loge Androgyne » ou « la secte des Anandrynes ». Après la mort de Louis XV en 1774, la belle « Sapho » perdit son immunité et fut renvoyée de la Comédie Française et emprisonnée au Temple, qui était alors la prison pour dette. Elle s’enfuit en Russie et rentra trois ans plus tard grâce à la protection de Marie-Antoinette. Ses funérailles en 1815 à l’église Saint Roch furent l’objet d’un nouveau scandale. Elle habitait cette paroisse, et bien qu’elle ait fait à l’église des dons considérables, l’entrée de ses restes mortels fut refusée par le curé. Le peuple indigné enfonça les portes. Alerté, Louis XVIII, envoya un de ses aumôniers pour célébrer l’office funèbre. Elle a été inhumée au cimetière de l’Est (Montparnasse)