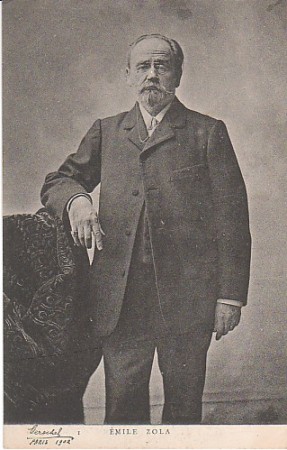Mémorial des Martyrs de la Déportation, Paris
Photo : Eric, du blog Paris, one photo a day
Hier soir, à la Mairie du 9ème, a été inaugurée l’exposition "Les Enfants de Buchenwald". Inutile de rappeler toute l’horreur des camps de concentration que le 60ème anniversaire de leur libération ramène à notre mémoire.
Notre arrondissement est depuis longtemps un lieu d'accueil pour la communauté juive qui y est encore aujourd'hui importante. En témoignent les 9 synagogues dont bien sûr la Grande Synagogue de la rue de la Victoire sans oublier le Consistoire.Le 9ème fut aussi un lieu de drames. Les plaques apposées au lycée Lamartine, dans les écoles de la rue Buffault et de la Victoire sont là pour nous rappeler que des enfants de notre quartier furent déportés.
L'exposition s'intéresse aux destins individuels. Elle retrace, avec des photos, la vie d’une quinzaine d’adolescents déportés. Elle présente des documents encore jamais montrés touchant leur vie avant la déportation, leur vie dans le camp et leur retour à la vie. On y voit des enfants en vacances avec leurs parents en 1937-38, des enfants jouant avec leurs copains à la même époque. Des camps, pas de photos. Des dessins réalisés par ces enfants juste après la libération des camps sont très émouvants. Enfin la reconstruction, le retour à la vie. Symboliques, quelques clichés des mêmes personnes avant leur déportation, petits enfants, et dans les années 80. On comprend que des liens indissolubles se soient créés.
En coordination avec les Directeurs des établissements scolaires de l'arrondissement, la Mairie va organiser des visites pour ce travail de mémoire.
La présence de quelques déportés à cette inauguration et surtout leurs témoignages a rendu la manisfestation très poignante.
Le camp de Buchenwald
Entré en activité en juillet 1937, le camp de Buchenwald a été installé à quelques kilomètres de Weimar, en pleine forêt. On y interne d’abord des prisonniers politiques allemands, antinazis, bientôt rejoints par des internés juifs, transférés de Dachau, et par des Juifs autrichiens arrêtés en 1938, après l’Anschluss. Par la suite, arrivent en nombre des convois de Juifs polonais, puis des prisonniers en provenance des pays d’Europe occidentale, résistants et Juifs ; enfin, en 1944, des Juifs de Hongrie, tous destinés au travail forcé puisqu’il n’existait pas de chambres à gaz à Buchenwald.
La mortalité dans le camp est cependant effroyable, ce qui explique la présence de deux fours crématoires.
Les enfants de Buchenwald
La plupart des enfants rescapés sont d’origine polonaise (250 sur les 427 arrivés en France) ; les autres viennent de Roumanie (118), de Tchécoslovaquie (49), de Hongrie (43), quelques-uns de Lituanie et d’Allemagne. Issus pour la plupart de familles rassemblées dans les ghettos de Pologne, certains d’entre eux ont été déportés vers Auschwitz entre 1942 et 1944 où ils ont travaillé, pendant toute la durée de leur internement, jusqu’au moment de leur évacuation, à l’approche des Soviétiques.
Les trois plus jeunes du groupe, David, Lulek et Izio ont respectivement 8 et 10 ans. Ils sont arrivés en janvier 1945 venant de Czestochowa. Tous ces jeunes ont donc « fait la marche de la mort » de Pologne vers l’Allemagne.
A leur arrivée à Buchenwald, ces enfants et adolescents ont été placés en quarantaine dans les baraques du petit camp, puis dirigés vers les blocks 8 et 66, sous la protection de la résistance interne.
Le camp de Buchenwald s’est libéré par lui-même, avant l’arrivée des Américains. Dans les derniers jours, les Allemands évacuent et massacrent un grand nombre de prisonniers, juifs essentiellement. Certains sont transportés jusqu’au camp de Theresientadt, libéré le 8 mai 1945. Beaucoup de prisonniers sont morts en route ou après la Libération.
De Buchenwald, les ressortissants des différents pays sont rapatriés dans leurs pays. Mille jeunes Juifs, qui ne veulent retourner ni en Pologne, ni en Hongrie, attendent un pays d’accueil. 427 d’entre eux ont été accueillis par la France ; les plus malades vont en Suisse, d’autres en Suède retrouver des membres de leur famille.
L’accueil en France des enfants de Buchenwald
A leur arrivée en France le 6 juin 1945, ils sont dirigés vers le préventorium d’Ecouis, dans l’Eure. Ils y resteront six semaines. Au début du mois de juillet, 173 d’entre eux partent en Palestine, via Marseille, avec le Docteur Malkin, munis de visas officiels britanniques.
Les plus religieux et les plus jeunes, sont accueillis au château d’Ambloy, près de Vendôme, pour se « refaire une santé ». Ils y passent l’été 1945 avant d’être hébergés à Taverny, encadrés par deux jeunes éducatrices exceptionnelles, Judith Hemmendinger-Feist et Gaby Cohen-Wolff ; ces dernières, qui vivent aujourd’hui à Jérusalem et à Paris, leur redonneront le goût de vivre. Les plus jeunes sont dirigés vers Versailles en janvier 1946. Les plus âgés apprennent un métier dans les écoles professionnelles de l’ORT, qui ouvre des cours spéciaux à leur intention. Ils vont également travailler chez des artisans et vivent au foyer de la rue Rollin. En 1948, 117 jeunes sont émancipés parmi ceux de plus de 18 ans et poussés dans la vie active. Le passage d’une vie en collectivité extrêmement soudée à un cheminement individuel n’a pas toujours été facile : mais tous ont franchi les obstacles ; la plupart se sont remarquablement adaptés et ont su construire leur vie d’adulte en France, aux USA, en Israël, au Canada, en Australie ou dans d’autres pays européens.
Parmi eux, citons Elie Wiesel, ou l’ancien Grand Rabbin d’Israël, Meïr Lau.
C’est grâce à l’association Œuvre de Secours aux Enfants (OSE) que tout ce travail a été possible.
Vous pouvez aussi regarder l'article "Les yeux de la mémoire" publié par nos confrères et amis de Paris14.info
Les Enfants de Buchenwald
du 18 au 31 Octobre 2005
Mairie du 9ème
6 rue Drouot
du Lundi au Vendredi de 11h à 17h
Nocturne le Jeudi jusqu'à 19h30